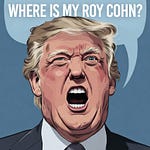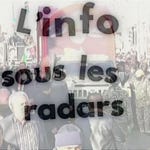Une retranscription en français de ce podcast est à trouver plus bas.
Claire Fox est la présidente de The Academy of Ideas, une organisation qui vise à encourager et développer l’esprit et le débat critique dans la société britannique. Elle est également parlementaire, siégeant à la Chambre des Lords, équivalente de notre Sénat.
Comme cela semble être le cas de partout en Occident - à part peut-être aux Etats-Unis - la démocratie représentative britannique est en crise, pour la simple raison que l’électorat n’est plus équitablement représenté. Avec 35% des voix recueillies lors des dernières législatives de 2024, le parti travailliste détient la majorité absolue avec 62% des sièges. Est-ce le résultat d’un mode de scrutin aujourd’hui inadapté ou bien le signe d’un malaise plus profond?
Le Brexit n’a pas résulté en la nuée de criquets et les neuf autres plaies de Bruxelles qu’on avait promis à nos amis d’outre-Manche. Et si les problèmes économiques auxquels fait face le Royaume-Uni étaient endémiques? Et si l’UE n’avait somme toute aucun impact?
La liberté d’expression au Royaume-Uni est de plus en plus contrôlée – et de manière aussi découplée qu’inéquitable. Dernière manifestation en date, au festival de Glastonburry, le groupe Bob Vylan a scandé “death the IDF” – mort à l’armée israélienne. Pas mort à Israël ou mort aux juifs. Notez bien l’importante nuance, qui fait que cette diatribe, qu’on soit d’accord avec ou pas, peut difficilement être pénalement caractérisée. Une enquête criminelle a été ouverte. La sinon très pudibonde BBC, qui retransmet toujours ses directs avec un délai afin d’avoir le temps de censurer, ne l’a pas en l’espèce fait. Les sociétés occidentales semblent être en permanence coincées entre deux formes d’injonctions comminatoires et contradictoires. Avec une criminalisation à outrance et une justice qui a d’ores et déjà perdu sa crédibilité, car considérée, à juste titre, comme partiale, alors que de tels propos relèvent de la légitime controverse politique, comment cela pourrait-il mal finir ?
Enfin, force est de constater que le multiculturalisme, une idéologie imposée aux sociétés occidentales depuis la fin des années 1980, est un échec abouti. Plusieurs peuples sur le même territoire auxquels des règles différentes sont appliquées en fonction des origines et des croyances, est-ce viable?
L’Éclaireur : Merci beaucoup, Claire Fox, de prendre le temps de répondre à nos questions. On observe à travers l’Occident une crise profonde de la démocratie représentative. Qu’en est-il au Royaume-Uni ?
Claire Fox : La situation est intéressante. Le système électoral britannique repose sur le scrutin majoritaire à un tour, ce qui a longtemps suscité des débats. Beaucoup estiment qu’il faut passer à un système de représentation proportionnelle pour permettre à de nouveaux partis d’émerger. Avec le système actuel, il est possible de recueillir des millions de voix sans obtenir beaucoup de sièges au Parlement, ce qui donne l’impression que certains électeurs ne sont pas entendus.
Cependant, lors des dernières élections générales, un changement notable s’est produit. Le mécontentement a, en quelque sorte, fait céder les digues. Contrairement au système bipartisan traditionnel – dominé par les conservateurs et les travaillistes, avec les libéraux-démocrates en troisième position – de nouveaux acteurs ont percé.
D’un côté, cinq indépendants, des islamistes, des extrémistes, ont été élus députés, ce qui est préoccupant. De l’autre, le parti Reform UK, dirigé par Nigel Farage, un parti populiste plus classique, a également remporté cinq sièges, malgré le mode de scrutin. Ce qui est frappant, c’est l’effondrement des partis traditionnels. Même leurs partisans commencent à envisager la proportionnelle pour améliorer leurs chances de remporter plus de sièges.
Plus largement, les citoyens ne se sentent ni représentés ni écoutés. Reform UK gagne du terrain – les sondages indiquent qu’il serait en tête si des élections avaient lieu aujourd’hui – précisément à cause de cette désillusion.
Ce parti créé récemment incarne une révolte contre des partis traditionnels devenus technocratiques, tournés vers les institutions internationales et souvent méprisants envers les préoccupations des gens ordinaires. Cette montée de Reform UK reflète donc la crise de la politique représentative.
L’Éclaireur : Malgré tout, vous semblez coincés avec Keir Starmer. Une majorité travailliste aussi écrasante, c’est inédit au Royaume-Uni, non ?
Claire Fox : Oui, mais cette majorité impressionnante repose sur une base électorale fragile : seulement environ 35 % des voix. Beaucoup ont voté pour Starmer par désillusion envers les conservateurs qui, après quatorze ans au pouvoir, ont trahi leurs promesses. Certains électeurs historiquement travaillistes avaient soutenu les conservateurs en 2019 pour le Brexit, un phénomène très britannique. Boris Johnson avait remporté cette élection en promettant de concrétiser le Brexit.
Keir Starmer a été légitimement élu l’an dernier selon notre système, mais sa popularité s’effondre déjà. Le soutien au Parti travailliste chute rapidement. Avec des élections prévues tous les quatre à cinq ans, nous devons assumer les conséquences de ce vote démocratique, même si le mécontentement grandit. Il peine à faire adopter ses politiques en raison de rébellions, y compris au sein de son propre parti. Par exemple, certaines réformes sociales prévues cette semaine ont été abandonnées après un revirement complet.
L’Éclaireur : Vous avez mentionné le Brexit. Est-ce vraiment aussi catastrophique que ce que l’on pense en Europe continentale ?
Claire Fox : Non, pas du tout. Le Brexit n’était pas une finalité en soi, mais une décision de reprendre en main la souveraineté britannique : permettre aux Britanniques de décider de leurs propres lois, de contrôler leurs frontières, sans ingérence de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe.
C’était censé être disruptif. Le problème, c’est que le référendum de 2016 a désarçonné l’élite politique, qui s’attendait à un vote pro-UE. Après le résultat, elle a tout fait pour bloquer le Brexit, sans jamais chercher à en tirer des conséquences positives. Les prévisions alarmistes d’un effondrement économique ne se sont pas réalisées. Les difficultés économiques du Royaume-Uni existaient déjà dans l’UE, dues à une productivité stagnante, et elles n’ont pas été correctement traitées depuis.
Accuser le Brexit de tous les maux est devenu une excuse facile. Bien que peu de résultats concrets soient associés au Brexit, il a incarné une révolte démocratique authentique. Les citoyens ont affirmé : « Nous ne voulons pas être ignorés. Nous avons une voix et méritons le respect. » Cet esprit persiste, même si beaucoup de promesses du Brexit n’ont pas été tenues.
Aujourd’hui, Keir Starmer, qui avait tenté de renverser le résultat du référendum en poussant pour un second vote, est au pouvoir. Bien qu’il dise accepter le Brexit, il cherche à « réinitialiser » les relations avec l’UE, en se rapprochant de figures comme Ursula von der Leyen. Dans les récentes négociations commerciales, le Royaume-Uni a fait des concessions, notamment sur la souveraineté, ce qui a suscité des tensions, par exemple sur les quotas de pêche – un sujet sensible, surtout avec la France.
L’Éclaireur : Oui, les quotas de pêche, un conflit récurrent ! Concernant le multiculturalisme au Royaume-Uni, est-ce un échec ? J’ai vu votre dernier article sur Substack à propos des questions de détermination des peines, qui était assez alarmant…
Claire Fox : Oui, le multiculturalisme, en tant que politique, est un échec. Mais il faut clarifier les choses. Le Royaume-Uni est une société multiethnique depuis des décennies, notamment en raison de son passé colonial, qui a permis à des personnes des anciennes colonies de s’installer ici. Cela a parfois créé des tensions, mais ce n’était pas nécessairement un échec. Il y a trente ou trente-cinq ans, un mouvement antiraciste universaliste et intégrationniste avait réussi à promouvoir l’égalité, sans discrimination basée sur l’origine ethnique.
Cependant, le multiculturalisme comme politique gouvernementale a pris une autre direction. En traitant les groupes ethniques et culturels comme des communautés distinctes, il a dépriorisé l’intégration au profit de l’identité communautaire. Avec la montée de la politique identitaire, les individus sont désormais perçus à travers leur race, leur religion ou leur origine – « en tant que musulman », « en tant que pakistanais », etc. Cela a fragmenté l’idée d’une identité civique commune, créant une atmosphère de division. Pire, les élites ont adopté une attitude paternaliste, considérant les minorités ethniques comme des victimes nécessitant une intervention constante de l’État. Cette approche a exacerbé les tensions et affaibli le sentiment d’unité nationale.
Cela a créé beaucoup de tensions, notamment parmi les Britanniques blancs, qui ressentent une hostilité croissante. La politique identitaire suggère que ceux qui ont la peau blanche – un trait inné, non choisi – bénéficient d’un privilège inhérent. Cela passe mal auprès des millions de travailleurs blancs ordinaires, qui luttent pour joindre les deux bouts et se sentent loin d’être privilégiés, souvent au bas de l’échelle sociale.
Cette situation est aggravée par l’usage abusif de termes comme « racisme » ou « bigoterie ». Dès que quelqu’un exprime des inquiétudes sur le multiculturalisme, on l’accuse de racisme ; s’il s’inquiète de l’islam radical, on parle d’islamophobie. Cela a conduit à des situations graves où les autorités ont fermé les yeux. Par exemple, lors de l’attentat de Manchester il y a moins de dix ans, qui a tué de nombreux jeunes à un concert d’Ariana Grande, des agents de sécurité avaient repéré un jeune homme avec un gros sac à dos, agissant de manière suspecte. Ils n’ont pas agi, de peur d’être accusés de racisme ou d’islamophobie. Ce jeune homme était un terroriste, et son attentat a causé un massacre. Cette peur d’être étiqueté raciste a fracturé la société, où l’on se voit uniquement à travers le prisme de l’identité.
L’Éclaireur : Y a-t-il une solution à cela ?
Claire Fox : La solution est de traiter tout le monde de manière égale devant la loi, sans privilège accordé en fonction de “caractéristiques protégées”, comme l’ethnicité ou la religion.
Récemment, le Conseil des peines a proposé que les rapports de condamnation pour certains groupes ethniques ou culturels soient rédigés de manière à éviter la prison, ce qui revient à une justice à deux vitesses.
Même le gouvernement travailliste a reculé face à cette proposition trop explicite, mais dans la pratique, une telle disparité existe souvent de manière informelle. Par exemple, une personne blanche condamnée pour incitation à la haine raciale risque une peine de prison plus lourde qu’une personne issue d’une minorité ethnique, qui pourrait invoquer sa condition de victime de racisme pour atténuer sa peine. De plus, la police hésite à intervenir dans des zones où des jeunes issus de minorités commettent des délits, de peur d’être accusée de racisme, ce qui crée un sentiment d’impunité.
Un autre problème majeur est l’immigration illégale, notamment via les petits bateaux en provenance de Calais. Ces migrants sont souvent qualifiés de demandeurs d’asile et traités avec indulgence, bénéficiant de services en attendant l’examen de leur dossier. La majorité obtient l’asile, car les évaluations sont souvent favorables, et même ceux qui sont refusés ne sont pas expulsés, en raison de lois sur les droits humains invoquant des risques de persécution.
Des criminels étrangers, coupables de crimes graves comme le viol ou le meurtre, évitent également l’expulsion grâce à des avocats spécialisés. Cela alimente des ressentiments, et je crains que cela ne conduise à un véritable racisme – non pas l’usage abusif du terme, mais une hostilité réactionnaire envers certains groupes ethniques. Pour éviter cela, il faut traiter tout le monde équitablement, sans favoriser une ethnicité, et cesser de qualifier d’extrémistes ceux qui soulèvent ces préoccupations.
En matière d’intégration, le problème est que nous ne savons plus ce que signifie être britannique. Le Brexit était porté par le désir de reprendre le contrôle de notre destin, mais cette identité s’est diluée. Il faut redéfinir ce que signifie être britannique pour permettre une intégration réelle.
L’Éclaireur : C’est un défi de taille. Et la liberté d’expression ? On entend que trente personnes en moyenne sont arrêtées chaque jour pour des publications sur les réseaux sociaux, certaines emprisonnées.
Claire Fox : La liberté d’expression est en péril, comme l’a souligné J.D. Vance à Munich. Sans équivalent au Premier amendement américain, nous pensions que la liberté d’expression était acquise, mais elle est sous pression. Les lois sur les crimes de haine et le concept de « discours de haine » se sont multipliés, surtout avec l’essor des réseaux sociaux.
La police surveille ces plateformes, traquant les discours jugés haineux, ce qui entraîne une hausse des poursuites – non pour des crimes physiques, mais pour des propos tenus. Le « discours de haine » est subjectif, ce qui en fait un outil vague pour sanctionner. Lors des émeutes de l’été dernier, liées à des tensions raciales, le gouvernement a réprimé les commentaires sur les réseaux sociaux.
Certaines violences étaient clairement racistes, comme des agressions contre des Britanniques d’origine asiatique, et méritaient des poursuites. Mais des gens exprimant leur frustration, par exemple sur l’inaction policière face aux réseaux de grooming (exploitation sexuelle) impliquant majoritairement des Pakistanais musulmans, ont été accusés de crimes de haine.
Keir Starmer, ancien chef du parquet, avait poursuivi ces réseaux, mais en tant que leader travailliste, il a évité d’en faire un sujet politique, car ces scandales touchaient des zones contrôlées par son parti. Les conservateurs n’ont pas fait mieux, et ce silence a alimenté la frustration, culminant dans les émeutes.
Le gouvernement a alors menacé sur les réseaux sociaux : « Attention à ce que vous publiez », instaurant une forme de délit d’opinion. Un projet de loi sur la liberté d’expression académique, que j’ai soutenu, a été abandonné par les travaillistes dès leur arrivée au pouvoir, montrant leur manque de priorité pour la liberté d’expression.
Un exemple récent est la controverse à Glastonbury, où le groupe Bob Vylan a scandé des slogans anti-armée israélienne1. La BBC, qui couvre massivement l’événement, n’a pas censuré ces propos, contrairement à son habitude pour d’autres sujets sensibles. Cela montre une incohérence : la liberté d’expression est défendue sélectivement.
Bien que ces propos soient choquants, je m’oppose à ce que l’État censure les festivals ou impose des scripts aux artistes. La liberté d’expression doit être défendue de manière cohérente, même pour des opinions offensantes. Sinon, on risque une censure plus large, utilisée contre toute opinion impopulaire, comme les débats sur le sexe biologique. Les réactions émotionnelles ne doivent pas mener à des lois répressives.
L’avenir du Royaume-Uni s’annonce turbulent, sans retour possible à l’ordre établi. Les voix populistes vont bouleverser le paysage politique, comme ailleurs en Europe. Les prochaines élections pourraient voir une chute des grands partis traditionnels. Cette vague populiste, bien que parfois autoritaire ou ethno-nationaliste – ce que je rejette – porte un potentiel démocratique révolutionnaire. C’est à la fois inquiétant et excitant, et je veux contribuer à façonner cette nouvelle ère.
Depuis, le parquet a ouvert une enquête.