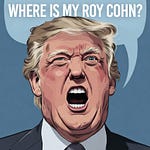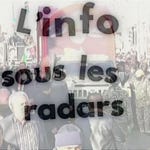Alors que Donald Trump vient d’imposer des droits de douanes de 25% à la République d’Inde au motif que les USA n’ont que peu de commerce avec elle, il nous semble important de re-publier notre entretien avec Kanwal Sibal, qui éclaire la position de ce géant démographique, économique, industriel et technologique qu’est l’Inde. 1,4 milliards d’habitants méritent une voix, ne trouvez vous pas?
La retranscription en français de ce podcast est à trouver plus bas.
Kanwal Sibal, président de l'Université Jawaharlal Nehru à New Dehli, ancien secrétaire général des affaires étrangères de la République d'Inde, partage avec nous sa vision de la marche du monde.
Kanwal Sibal est particulièrement bien placé, non pas pour donner des leçons mais pour nous éclairer, puisque qu’ayant été notamment ambassadeur en Egypte, en Russie et en France de 1998 à 2002, France où il débuta en 1968 sa carrière diplomatique. Il a vécu de l’intérieur le plus chaud de la guerre froide donc du non-alignement, l’illusoire hégémonie américaine, l’aussi illusoire néocolonialisme “globaliste” qui suivit la chute du mur, et l’embryon de ce qui allait devenir les BRICS.
Alors que l’UE à la dérive est en train de perdre le peu de crédibilité géostratégique qui lui restait du fait de postures et de politiques irrationnelles, Kanwal Sibal parle d’or.
Avec cette si délicate franchise indienne, serait-il en train de nous dire que nous, les Occidentaux, sommes des ullu da patha (littéralement des fils de hiboux, comprendre des imbéciles) ? Que nous serions incapables de ressentir le souffle du Qalandar alors que nous sommes si prônes à embrasser la version Indiana Jones de Kali ? Que nous avons cessé pour notre notre propre malheur d’essayer de comprendre le monde?
L’Inde, ce n’est pas nouveau, est un géant démographique. Elle est aujourd’hui un géant économique, industriel, scientifique, technologique et militaire. Bref, une puissance majeure qui persiste à ne pas dire son nom par refus de l’agressivité. Ils sont intrigants, ces 1,4 milliard d’amis non alignés.
Cessons donc les discussions de comptoirs - à Pondichéry ou ailleurs - et écoutons ce qu’on pense de nous, d’autant qu’en Inde on ne pense pas de mal de nous du tout. Ils sont intrigants, ces 1,4 milliard d’amis non alignés, tout de même.
L'Éclaireur : Kanval Sibal, bonjour et merci infiniment de prendre le temps de me parler. Vous étiez à Moscou la semaine dernière. Quelle était l’ambiance dans la capitale russe ?
Kanwal Sibal : Tout semblait assez normal. J’ai participé à une conférence très bien fréquentée, avec un public impressionnant. Nous nous sommes promenés un peu, notamment dans des endroits que je connaissais déjà, comme la place Rouge et ses environs. Bien sûr, nous avons aussi traversé de larges pans de Moscou en voiture, car j’avais des rendez-vous un peu partout. On n’avait pas du tout l’impression qu’une guerre était en cours.
Cela dit, je dois noter que beaucoup de boutiques occidentales qui étaient présentes – par exemple dans le centre commercial GUM – ont fermé leurs portes. Les marques françaises et allemandes ont disparu. En revanche, la présence chinoise est très marquée dans ce même GUM. Quelques entreprises italiennes, que je ne connaissais pas auparavant, ont remplacé les sociétés occidentales qui sont parties.
Pour répondre à votre question, les restaurants sont pleins, les rues grouillent de monde. On m’a dit que les voitures chinoises avaient remplacé les allemandes et qu’on ne voyait plus de Mercedes, de BMW ou d’autres marques similaires. Mais j’ai été un peu surpris, car ce n’est pas tout à fait exact. J’ai vu beaucoup de voitures allemandes dans les rues, ainsi que des japonaises, comme Toyota.
En venant de l’aéroport, j’ai aussi remarqué, sur le côté droit de la route, une enfilade de concessionnaires automobiles. Aujourd’hui, presque tous les constructeurs occidentaux ont été remplacés par des showrooms de marques chinoises. Et comme cela faisait quelques années que je n’étais pas revenu, j’ai constaté une augmentation des immeubles modernes et des gratte-ciel, surtout entre l’aéroport et le centre-ville. Dans le quartier des affaires de Moscou, les tours sont plus nombreuses. Mais dans le cœur historique – là où se trouvent la place Rouge, le Bolchoï et les monuments emblématiques – rien ne semble avoir changé.
L'Éclaireur : La routine, dirais-je ! Quelle est votre opinion sur le chaos sanglant qui secoue l’Europe en ce moment ? Je veux dire, du point de vue indien – une perspective que, malheureusement, nous n’entendons pas assez en Europe, alors qu’elle me semble cruciale.
Kanwal Sibal : Franchement, il est très difficile de comprendre pourquoi l’Europe agit comme elle le fait. Pendant longtemps, et à juste titre jusqu’à récemment, l’Europe s’enorgueillissait d’avoir surmonté les inimitiés du passé. Elle était un havre de paix, une zone fondée sur des valeurs plutôt que sur des questions de sécurité. Les conflits internes entre pays européens avaient été largement résolus, les guerres et les rivalités historiques dépassées.
L’Europe se présentait au monde comme un modèle de paix, d’harmonie sociale et de bien-être, un pilier d’un ordre mondial stable. Mais aujourd’hui, cette image d’un continent pacifique n’a plus aucune crédibilité.
Car, alors que Trump, pour des raisons qui lui sont propres, cherche une issue au conflit en Ukraine – en essayant de mettre fin à la guerre, de tendre la main à la Russie et de promouvoir une solution pacifique –, l’Europe fait tout son possible pour l’empêcher. Elle veut prolonger le conflit et n’a pas du tout abandonné sa rhétorique selon laquelle la Russie représente un danger pour l’Europe. Au contraire, elle a amplifié ce discours en affirmant que si la Russie l’emporte en Ukraine, les prochains sur la liste seraient la Pologne, les pays baltes, voire l’Europe occidentale.
C’est le narratif qu’on entend. Les Européens soutiennent inconditionnellement Zelensky, même s’il a perdu toute crédibilité – non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le Sud global – à cause de ses discours changeants, de son imprévisibilité et de sa détermination à entraîner l’Europe et les États-Unis dans un conflit bien plus large avec la Russie, au risque même de déclencher une Troisième Guerre mondiale. L’Union européenne n’a pas modifié cette posture, et son ton devient de plus en plus débridé.
Pire encore, à la tête de l’Union européenne, on trouve des personnalités comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas ou le responsable lituanien de la défense Andrius Kubilius – des figures farouchement anti-russes. Comment envisager que l’Europe prenne des initiatives pour la paix avec de tels dirigeants à Bruxelles ? Il y a aussi la première ministre danoise, Mette Frederiksen, déjà sous pression de l’Amérique de Trump à propos du Groenland, qui déclare qu’une guerre en Ukraine est préférable à une paix en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu’ils craignent que si les États-Unis parviennent à imposer une solution sans l’Europe, celle-ci perdra toute influence géopolitique.
Vu de l’extérieur, l’Europe veut augmenter ses budgets de défense et ses capacités militaires, alors que ses économies sont en difficulté et que beaucoup de pays sont lourdement endettés. Mais même si elle le voulait, renforcer ses forces armées ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prendra des années pour établir une base industrielle et constituer des armées crédibles.
Et que se passera-t-il si, demain ou après-demain, une résolution du conflit ukrainien survient ? Toute la logique de cette militarisation de l’Europe – qui repose sur une hostilité permanente avec la Russie – s’effondrerait. Cela se voit déjà dans des décisions comme l’accord de sécurité sur cent ans signé par le Royaume-Uni avec l’Ukraine, qui implique qu’ils ne prévoient pas de relations normales et amicales avec la Russie avant un siècle.
Si la paix s’installe, comment justifieront-ils cette hausse des dépenses militaires, surtout quand elles empiètent sur les budgets sociaux ? Il y a déjà des grandes tensions sociales sur le terrain.
Ce qui est encore plus troublant, c’est la trahison des valeurs mêmes de l’Union européenne. Elle se vantait autrefois de porter des principes qui devraient guider la gouvernance mondiale et de les diffuser à l’échelle planétaire. Mais aujourd’hui, elle agit à l’opposé de ces principes. Il y a de la censure, les médias russes sont interdits de diffusion en Europe.
Pourquoi l’Europe a-t-elle peur ? Même s’il y a de la propagande russe, ne devrait-elle pas avoir confiance en la maturité de son public pour distinguer les faits de la désinformation ? On parle de liberté d’expression, de tolérance pour la dissidence et les opinions divergentes. En France, par exemple, les positions d’extrême gauche ou d’extrême droite qui s’opposent à Macron sont acceptées – c’est cette diversité qui façonne le système politique.
Mais il y a aussi une guerre juridique en cours à travers le continent. En Roumanie, le candidat favori, qui aurait probablement gagné les élections, a été interdit de se présenter. En Géorgie, tout est fait pour déstabiliser le parti au pouvoir. La présidente géorgienne, d’origine française, a joué un rôle qui, vu de l’extérieur, ne semble pas respecter les meilleures pratiques constitutionnelles. On observe quelque chose de similaire en Moldavie.
En Serbie, on assiste à une tentative claire de provoquer un changement de régime, sur le modèle de Maïdan. En Slovaquie, il y a eu une tentative d’assassinat contre le premier ministre Fico, qui prône une approche raisonnée pour la désescalade et la paix en Europe. Quant à Viktor Orbán, qui plaide constamment pour le dialogue et la diplomatie avec la Russie, il est sans cesse attaqué.
Lors d’un récent vote sur l’aide à l’Ukraine, Orbán s’y est opposé – et le principe du consensus a été totalement ignoré. Son vote a été traité comme insignifiant.
L’Europe a aussi pris des mesures douteuses, comme la confiscation des réserves de change russes. Ils prétendent ne pas toucher au capital, mais utilisent les intérêts générés pour financer des armes et la reconstruction de l’Ukraine. Pour un observateur extérieur, cela n’a aucun sens : si le capital ne peut pas être saisi, comment les intérêts peuvent-ils l’être ? Ça ne tient pas debout.
L’Éclaireur : Les questions de défense ne relèvent clairement pas des compétences de l’UE. C’est pourquoi l’idée d’un commissaire européen à la défense est étrange. Ces gens semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. On dirait plutôt qu’ils s’accrochent au pouvoir et tentent d’empêcher les institutions européennes de s’effondrer, car elles deviennent de plus en plus impopulaires...
Kanwal Sibal : Oui, c’est pourquoi j’ai dit que l’UE s’arroge trop de pouvoir. Malheureusement, même les pays européens souverains adoptent aujourd’hui des positions qui nuisent à leur réputation. Prenons l’Allemagne, par exemple. Du chancelier Scholz à la direction actuelle, le ton et les postures sont étonnamment agressifs. Compte tenu de l’histoire allemande, je pensais qu’ils seraient prudents à l’idée que leurs armes soient à nouveau utilisées pour tuer des Russes. Mais le futur chancelier menace d’une confrontation accrue.
Quant à la France, j’ai toujours admiré sa politique étrangère, mais la ligne dure de Macron est surprenante. Avec des leaders comme Starmer, il semble mener la charge contre la Russie, poussant à une coordination des forces armées européennes pour d’éventuelles opérations. Quand ils parlent d’envoyer des forces de maintien de la paix, ils savent pertinemment que la Russie a catégoriquement rejeté l’idée de forces de l’OTAN – soi-disant des « casques bleus » – en Ukraine. L’ambassadeur russe à l’ONU l’a redit il y a quelques jours, mais l’Europe persiste. Macron a même déclaré qu’ils étaient en train de concrétiser cette décision, et des réunions entre chefs militaires ont déjà lieu pour planifier cela.
Ce type d’initiative – surtout venant de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni – me laisse perplexe. Quel est leur objectif ? Quand les États-Unis et l’Europe, sous Biden, étaient unis pour défaire stratégiquement la Russie, ils n’y sont pas parvenus. Comment l’Europe pense-t-elle y arriver seule maintenant, sans les États-Unis ? C’est tout simplement impossible.
Un autre problème est que des figures comme Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas ne sont pas arrivées au pouvoir toutes seules – elles ont été soutenues par les grands pays européens. Des leaders de petits États baltes, comme l’Estonie, ont une influence disproportionnée à Bruxelles. Ces pays ont des populations réduites, une exposition internationale limitée et aucune tradition dans les affaires internationales ou la nuance géopolitique. Leurs craintes vis-à-vis de la Russie sont compréhensibles vu leur passé sous l’ère soviétique, mais ces peurs – ou phobies – ne devraient pas dicter la politique étrangère de l’Europe.
Même des pays comme la Pologne, avec leur propre passif historique, ne peuvent pas être attendus d’adopter une approche équilibrée et à long terme avec la Russie. Alors, pour un observateur extérieur, il est déroutant de voir l’Europe emprunter cette voie. Quand Trump est revenu au pouvoir et semblait prêt à dialoguer avec la Russie pour résoudre le conflit ukrainien, je pensais que l’Europe saisirait l’occasion pour limiter ses pertes et s’impliquer diplomatiquement. Cela aurait été une couverture politique pratique.
Au lieu de cela, l’Europe parle maintenant de se séparer des États-Unis et de faire cavalier seul – en développant des capacités de défense indépendantes alors que ses économies sont en difficulté. En sus, on pourrait voir des guerres commerciales entre l’Europe et les États-Unis, ce qui nuirait aux deux parties.
Trump a été très clair sur le fait que l’Ukraine n’intégrera pas l’OTAN et que les États-Unis ne s’impliqueront pas dans un conflit avec la Russie. Je pensais que c’était un signal suffisant pour que l’Europe baisse le ton et tente de façonner une autre position, soutenant l’idée de trouver une solution au conflit, plutôt que cette posture de faire cavalier seul, que personne ne trouve crédible.
L’Éclaireur : Il pourrait y avoir une autre explication. L’Union européenne essaie d’accroître ses compétences à travers les crises et ce qu’on appelle « l’empiétement des compétences », un phénomène typique des bureaucraties qui ne sont pas tenues en laisse. C’est aussi une des hypothèses avancées. L’Inde est-elle toujours un pays non aligné ?
Kanwal Sibal : Oui, dans le sens où nous avons maintenu nos liens avec la Russie, malgré les fortes pressions de l’administration Biden et de l’Europe. Il y a environ trois ans, quand von der Leyen est venue chez nous, elle nous a sermonnés, disant que nous étions du mauvais côté de l’histoire et qu’il était moralement impératif pour l’Inde de soutenir l’Ukraine et de condamner l’agression russe. Elle était très mécontente que nous nous abstenions lors des votes au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale de l’ONU, et que nous achetions du pétrole russe. Mais cette fois-ci, quand elle est revenue, le ton avait complètement changé.
L’Éclaireur : Peut-être a-t-elle réalisé que le pétrole que vous achetiez à la Russie était raffiné en Inde et revendu à l’Europe comme carburant dont nous avions grand besoin.
Kanwal Sibal : Oui, c’est un fait. Mais au-delà de ça, je remarque que même un journal comme The Economist, traditionnellement biaisé et critique envers l’Inde, a récemment publié un article louant notre politique – disant que l’Inde a réussi à maintenir des relations avec les deux camps et a excellé dans sa diplomatie, un exemple que d’autres devraient suivre. Mais mettons cela de côté. En parallèle, nous avons entretenu de très bonnes relations avec l’administration Biden. Avec le temps, ils ont cessé de nous presser de réduire nos liens avec la Russie.
Sur le commerce du pétrole, je peux vous partager quelque chose que vous savez peut-être déjà : l’ambassadeur américain en Inde a déclaré, lors d’un événement public ici, que les États-Unis avaient conseillé à l’Inde de continuer à acheter du pétrole russe, car cela maintiendrait les prix bas à l’échelle internationale et aiderait les consommateurs américains. Il y a donc des jeux dans les jeux. Je ne pense pas que ce soit vrai – nous avons pris une décision de notre propre chef. Mais passons. Pendant les quatre ans de l’administration Biden, nos relations avec le gouvernement américain se sont considérablement développées.
Ainsi, nous avons de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Russie, avec l’Europe, et nous avons laissé la porte ouverte à la Chine. La Chine est peut-être notre deuxième plus grand partenaire commercial – 130 milliards de dollars d’échanges – même si nos forces s’affrontent à la frontière. Nous maintenons cette ouverture car elle a multiplié nos options. Si nous coupions les ponts avec la Chine, nous deviendrions bien plus vulnérables aux pressions d’autres acteurs.
Mais en même temps, nous participons aussi aux efforts pour dissuader la Chine – que ce soit via le Quad (dialogue quadrilatéral pour la sécurité), l’Indopacifique ou nos relations très solides avec le Japon et les Philippines. D’ailleurs, nous avons fourni des missiles très avancés aux Philippines. Jusqu’à présent, je pense que nous avons réussi à jouer ce jeu d’équilibre, en poursuivant notre objectif de politique étrangère déclaré d’être en bons termes avec tous les pays, avec un succès raisonnable.
L’Éclaireur : Y compris avec le Pakistan, d’ailleurs, qui est…
Kanwal Sibal : Non, pas avec le Pakistan.
L’Éclaireur : Pas avec le Pakistan, d’accord (rires) !
Kanwal Sibal : Avec le Pakistan, c’est différent. Le Pakistan est en train de s’effondrer. Comme vous le savez, il traverse d’énormes difficultés internes. C’est un désastre total. Leur politique est un chaos complet. Mais ce qui a encore aggravé ce chaos, c’est leur objectif stratégique de propulser les talibans au pouvoir en Afghanistan. Dans ce contexte, le Pakistan ne représente pas un problème pour nous en ce moment.
Même le corridor économique sino-pakistanais et le port de Gwadar rencontrent de grandes difficultés à cause du Front de libération du Baloutchistan (groupe armé qui réclame l’indépendance de cette province du sud-ouest du Pakistan, ndlr), qui attaque des travailleurs chinois, parfois accompagnés de soldats pakistanais. Ce projet, qui nous préoccupait, est donc au point mort. Sinon, la situation à la frontière est relativement calme – dans le sens où le Pakistan est tellement englué dans ses propres problèmes qu’il a peu de temps pour promouvoir le terrorisme en Inde, même s’il continue à faire des petites provocations par-ci par-là.
L’Éclaireur : Qu’en est-il des relations entre l’Inde et l’Afrique, qui ont développé des liens solides ces trente dernières années ?
Kanwal Sibal : En réalité, c’est bien plus que trente ans. Dès notre indépendance, nous avons rompu nos relations avec l’Afrique du Sud à cause de l’apartheid. Nous avons soutenu Nelson Mandela et les mouvements de libération africains sur le plan politique. J’ai moi-même servi en Tanzanie et rencontré à l’époque des figures comme Mugabe ou Sam Nujoma. Nous leur apportions un soutien politique au sein du Mouvement des non-alignés et des Nations Unies.
Nous avons des communautés indiennes importantes en Afrique de l’Est, notamment au Kenya et en Tanzanie, qui ont été des vecteurs de notre activité dans la région. Nos liens avec l’Éthiopie sont historiquement très forts, et nous les avons aidés de multiples façons. Nous avons également créé la première académie militaire au Soudan.
Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, nos entreprises sont très actives, notamment dans les télécommunications et l’informatique. Nous proposons aussi des programmes de formation bien financés pour les fonctionnaires africains, dont beaucoup ont été formés en Inde au fil des années.
Cependant, la Chine a tellement pénétré l’Afrique qu’elle nous a largement dépassés. Si l’on compare ses activités aux nôtres, il y a clairement un déséquilibre, même si nous avons coopéré avec l’Afrique bien avant la Chine. Mais notre approche est différente. Nous réalisons des projets que les Africains veulent vraiment, en évaluant leurs besoins et en y répondant, plutôt que de l’utiliser, comme la Chine avec son initiative « Belt and Road », comme une plateforme pour écouler ses excédents de capacité dans les infrastructures ou ailleurs.
L’approche de l’Inde est plus centrée sur l’humain, avec une plus grande volonté de transférer des technologies. Dans le secteur de la santé, nous sommes très actifs : 40 % des médicaments génériques achetés par les États-Unis viennent d’Inde, et nos génériques sont très populaires en Afrique.
Sur la question d’un monde multipolaire : quand j’étais secrétaire général aux affaires étrangères, j’ai été impliqué dans le dialogue RIC (Russie-Inde-Chine). Cette initiative venait de M. Primakov, alors premier ministre russe, à une époque de politique étrangère unilatérale des États-Unis, notamment autour de l’Irak. L’idée était que si la Russie, l’Inde et la Chine s’unissaient, elles pourraient faire contrepoids à cet unilatéralisme américain. Cela n’a pas fonctionné comme prévu, car nos relations avec la Chine restent compliquées et nous nous méfions d’eux. Mais cette plateforme existe.
Ensuite, le RIC est devenu BRIC avec l’ajout du Brésil pour une portée plus intercontinentale, puis la Chine a intégré l’Afrique du Sud dans les BRICS, non pas pour des raisons économiques, mais politiques. Aujourd’hui, cinq autres pays, principalement du Moyen-Orient – comme l’Iran, l’Égypte, l’Indonésie ou l’Éthiopie – ont rejoint les BRICS, et beaucoup d’autres sont devenus membres associés. Ces pays cherchent à se protéger en diversifiant leurs alliances. Ils ne veulent pas être dominés par l’Occident et recherchent des liens avec des pays non occidentaux pour gagner en marge de manœuvre sur la scène internationale.
Quant au G20, il réunit les pays du G7 et les grandes économies émergentes. L’Inde y a été extrêmement active et a réussi à réorienter l’agenda du G20, initialement centré sur les priorités du G7, vers les préoccupations du Sud global. Cela contribue à la multipolarité en reconnaissant que les problèmes mondiaux ne peuvent pas être abordés uniquement du point de vue des pays développés.
Sur la multipolarité, les BRICS et le G20 incarnent cette ambition. Les nouveaux membres des BRICS et le virage du G20 vers le Sud global reflètent un monde où la domination occidentale s’effrite. Mais un monde vraiment multipolaire reste difficile à envisager pleinement.
La Russie reste un pôle, grâce à son statut à l’ONU et son influence en Asie centrale ou en Afrique. La Chine en est un autre, avec sa puissante économie. L’Inde, bien que non membre permanent du Conseil de sécurité, est une voix du Sud global et une économie en croissance – bientôt la troisième mondiale. Nous sommes une sorte de « demi-pôle », courtisés par l’Occident, la Russie, la Chine et le Sud, tout en conservant notre indépendance.
Pour nous, la multipolarité n’est pas anti-occidentale, contrairement à la vision russo-chinoise. C’est une aspiration légitime à jouer un rôle plus grand dans la gouvernance mondiale, en diluant les anciennes et nouvelles hégémonies. C’est pourquoi nous disons qu’avant de parler d’un monde multipolaire, il faut d’abord une Asie multipolaire – et le sens de cette idée est clair.