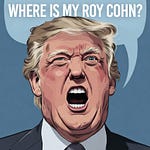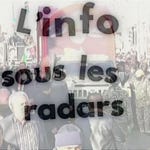Nous republions notre podcast du 12 mars 2025.
Officier de réserve de l’armée de terre, ancien analyste au ministère de la défense, Benoît Paré a une très longue expérience des missions internationales en zone de conflit, plus particulièrement au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour le compte de laquelle il a participé au monitoring du cessez-le-feu dans le Donbass de 2014 à mars 2022. Il consigne ce qu’il a vu ces huit années durant dans un livre dont nous vous conseillons fortement la lecture.
Contrairement à ce que les médias occidentaux répètent en boucle, il n’y a pas d’animosité des populations russophones du Donbass vis-à-vis des Ukrainiens de l’Ouest. L’inverse en revanche…
Depuis le coup d’Etat de Maïdan qui a vu les “ultra-nationalistes” ukrainiens – appelons-les par leur nom, les néo-nazis - être mis au pouvoir par l’Occident, Etats-Unis en tête, les exactions ont été multipliées par Kiev, qui a utilisé des “bataillons de volontaires”, les ATO, pour faire cette sale besogne. Ils ont été mis en place par celui qui a été sans discontinuer ministre de l’intérieur de 2014 à 2020, secondé par Eka Zgouladzé – à l’époque épouse de Raphaël Glucksmann – Arsen Avakov. Homme lige de Washington, il a complètement disparu des radars depuis le début l’opération spéciale russe.
Ce que rapporte Benoît Paré est vertigineux, et bien loin des narratifs aussi aseptisés et mensongers que la grande presse débite sur cette guerre qui dure depuis onze ans. En soutenant les extrémistes pour leur haine des Russes, l’Occident n’a t-il pas créé en Ukraine la même chose qu’il créa en Afghanistan durant l’occupation soviétique, un monstre qui viendra lui arracher la main ?
Vous trouverez ci-après un résumé de ce long entretien.
L'Éclaireur - Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’OSCE, une organisation peu connue, et quelles sont ses missions ?
Benoît Paré - L’OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a été créée en 1975 sous le nom de Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Elle réunissait les pays occidentaux et ceux de l’ex-URSS pour favoriser le dialogue et éviter un conflit mondial. Ses priorités incluent la démocratisation, les droits humains et le contrôle des armements.
Jusqu’à la chute de l’URSS, elle fonctionnait discrètement avec des réunions annuelles. Après l’effondrement soviétique, elle a perdu de son importance, mais la guerre en Bosnie-Herzégovine lui a donné un nouveau rôle. L’ONU, décrédibilisée après plusieurs années de conflit, a cédé la place à l’OSCE pour organiser les premières élections post-guerre après les accords de Dayton.
L'Éclaireur - Petite précision, les accords de Dayton datent de 1995, n’est-ce pas ?
Benoît Paré - Oui, ils ont été finalisés en novembre et signés à Paris le 14 décembre 1995. À cette époque, je travaillais à l’état-major de la Force d’action rapide française, sous les ordres du général Morillon, qui s’était distingué à Srebrenica en promettant la protection de l’ONU aux habitants. Après cela, il a été rappelé en France et mis à l’écart, malgré sa notoriété.
Pour revenir à l’OSCE, après Dayton, les grandes puissances ont cherché une alternative à l’ONU, jugée inefficace. Elles ont créé un poste de haut représentant international et confié à l’OSCE l’organisation des élections en Bosnie, sa première mission d’envergure. J’y ai participé par hasard, d’abord comme militaire, puis en tant que civil après avoir intégré l’OSCE. J’ai commencé par des missions courtes, puis des contrats plus longs, jusqu’à rejoindre l’Ukraine en 2015.
L'Éclaireur - Quelle était la mission de l’OSCE en Ukraine ?
Benoît Paré - La mission en Ukraine était spécifique, détaillée dans mon livre Ce que j’ai vu en Ukraine. Nous devions recueillir des informations sur les incidents de manière neutre, surveiller le respect des droits humains et faciliter le dialogue sur le terrain. Ce dernier point, bien que simple sur le papier, était extrêmement difficile. L’OSCE, comme ses États membres, ne reconnaissait pas les républiques autoproclamées du Donbass, ce qui compliquait les interactions avec elles. En revanche, les contacts avec le gouvernement ukrainien étaient fluides. Ce déséquilibre nous empêchait d’être pleinement neutres, contrairement à notre mandat. J’ai tenté de faire évoluer les choses en interne, sans succès. Ce qui m’a finalement poussé à démissionner.
L'Éclaireur - Cette mission n’était-elle pas une façade, une manière pour l’Occident de prétendre agir sans vraiment s’engager ?
Benoît Paré - Au départ, personne ne savait où cela mènerait. La mission a été créée le 21 mars 2014, juste après le référendum en Crimée du 16 ou 17 mars, qui a conduit à son rattachement à la Russie. Les événements, marqués par l’apparition des « petits hommes verts », se sont enchaînés rapidement, prenant les puissances occidentales par surprise. La mission a été montée à la hâte pour observer la situation, mais sans conflit armé initial.
Tout a changé avec l’opération antiterroriste (ATO) lancée par le président ukrainien par intérim le 7 avril, qui a dégénéré en guerre ouverte. Les premiers observateurs, des civils non formés aux questions militaires, étaient mal préparés. Des prises d’otages par les séparatistes en avril-mai ont encore compliqué les choses, gelant le recrutement jusqu’en septembre. L’organisation était chaotique, avec des contrats courts et un mélange de civils, militaires et policiers, sans direction claire. L’OSCE courait après les événements.
L'Éclaireur - Quand la mission est-elle passée à la surveillance du cessez-le-feu ?
Benoît Paré - Cela a commencé avec les accords de Minsk 1 en septembre 2014, qui ont donné à l’OSCE un rôle de surveillance du cessez-le-feu. Cela a relancé la mission, avec un recrutement axé sur des profils militaires. Cependant, la situation s’est encore dégradée, menant à Minsk 2 en février 2015. Ces accords, appelés « Paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk », précisaient 13 points, dont la surveillance des violations du cessez-le-feu et du retrait des armes lourdes, missions exclusivement confiées à l’OSCE.
L'Éclaireur - Pouvez-vous retracer la dynamique du conflit qui a conduit à Minsk 1 et Minsk 2 ? Il semble que l’armée ukrainienne, entraînée par l’OTAN depuis la révolution orange de 2004, ait subi deux lourdes défaites face aux milices séparatistes, non ?
Benoît Paré - Oui, je l’explique dans le premier chapitre de mon livre pour contextualiser. Au printemps-été 2014, l’armée ukrainienne a d’abord pris l’avantage. Le 13 juin, elle a repris Mariupol avec le bataillon Azov. Le 5 juillet, les séparatistes, dirigés par Igor Strelkov, un ancien officier russe, ont abandonné Slavyansk, Kramatorsk et d’autres zones pour se replier vers Gorlovka, devenue la ligne de front. À ce moment, les séparatistes étaient en difficulté, manquant de moyens. Strelkov s’en est plaint publiquement, niant un contrôle direct de Moscou. Il aurait été envoyé par le président de Crimée pour aider les séparatistes. En juillet-août, la situation s’est inversée en faveur des séparatistes, probablement grâce à une aide russe, bien que je n’aie pas de preuves formelles. Ce retournement est difficile à expliquer autrement.
L'Éclaireur - Il y a eu de lourdes défaites ukrainiennes à ce moment-là, n’est-ce pas ?
Benoît Paré - Oui, notamment à Ilovaïsk en août 2014. Les forces ukrainiennes ont été encerclées et contraintes de battre en retraite, marquant un tournant en faveur des séparatistes. Des sources comme Wikipédia mentionnent des unités russes aux côtés des séparatistes, mais cela reste à prendre avec prudence. Ce revers a poussé l’Ukraine à signer les accords de Minsk 1 pour stabiliser la situation.
L'Éclaireur - Et les « petits hommes verts » en Crimée, étaient-ce des forces russes ou des soldats ukrainiens ayant retiré leurs insignes ?
Benoît Paré - Les « petits hommes verts » étaient des individus sans insignes qui ont facilité la prise de contrôle de la Crimée par les indépendantistes. Leur identité n’a jamais été officiellement confirmée, mais on soupçonne fortement des soldats russes, soit de la base navale de Sébastopol, soit envoyés discrètement. La transition s’est faite presque sans violence, avec seulement deux morts dans des incidents isolés. Strelkov a revendiqué sa participation en Crimée, précisant qu’ensuite, le président criméen l’a envoyé dans le Donbass pour soutenir les républiques séparatistes.
L'Éclaireur - Revenons à Maïdan. Il est aujourd’hui établi que c’était un coup d’État orchestré par l’Occident, principalement les États-Unis, avec une forte implication britannique et, moins évoquée, allemande. Que s’est-il vraiment passé ?
Benoît Paré - Je ne suis pas sûr que les médias dominants reconnaissent Maïdan comme un coup d’État.
J’ai pris conscience de cette réalité grâce à la thèse d’Ivan Katchanovski, un politologue ukrainien de l’université d’Ottawa. En 2015, il a publié une étude de 72 pages démontrant que la plupart des victimes de Maïdan n’ont pas été tuées par la police de Ianoukovitch, comme le prétendait la version officielle, mais par des tireurs embusqués positionnés dans des bâtiments contrôlés par l’opposition, notamment Svoboda, un parti d’extrême droite néo-nazi. Son travail, appuyé par des heures de vidéos journalistiques, est rigoureux et difficilement contestable.
Cela m’a convaincu que Maïdan était un coup d’État. Une conversation interceptée entre Victoria Nuland, alors au Département d’État américain, et l’ambassadeur américain à Kiev, datant d’avant le massacre du 18-20 février 2014, montre qu’ils discutaient de la composition du futur gouvernement ukrainien, désignant Arseni Iatseniouk comme Premier ministre, ce qui s’est concrétisé après le coup d’État.
L'Éclaireur - Une autre conversation interceptée impliquait Catherine Ashton, alors haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, et un envoyé spécial, peut-être estonien. Qu’en est-il ?
Benoît Paré - Oui, cette conversation, enregistrée après Maïdan, mettait en scène un envoyé spécial de l’UE à Kiev, peut-être finlandais ou estonien, rendant compte à Catherine Ashton. Il rapportait les propos d’une médecin du mouvement Maïdan, troublée par le fait que les mêmes armes avaient visé à la fois des manifestants et des policiers. L’envoyé trouvait cela suspect, mais Ashton a éludé, disant simplement « intéressant » avant de passer à autre chose. Cela suggère soit qu’elle était au courant d’une manipulation, soit qu’elle préférait éviter un sujet qu’elle ne maîtrisait pas.
L'Éclaireur - Dans le Donbass, avez-vous observé un sentiment anti-ukrainien profond parmi les populations russophones, comparable à la haine anti-russe dans l’ouest de l’Ukraine, notamment à Lviv ?
Benoît Paré - Non, je n’ai pas constaté une haine équivalente. Certains Ukrainiens exprimaient une aversion viscérale envers les séparatistes et les Russes, mais dans le Donbass, les gens voulaient surtout qu’on les laisse tranquilles, vivre selon leurs valeurs et parler leur langue. Ils ne cherchaient pas à imposer le russe à l’ouest de l’Ukraine.
Une candidate à la mairie de Kramatorsk, du parti de Medvedchuk, m’a dit : « Nous voulons vivre comme avant, en parlant notre langue. Pourquoi l’ouest veut-il nous imposer la sienne ? » Quand je demandais aux habitants s’ils envisageraient de revenir sous l’autorité ukrainienne, beaucoup répondaient que c’était impossible après les bombardements et le sang versé. Ils se sentaient considérés comme des terroristes par Kiev, même les civils, ce qui brisait leur confiance. Mais je n’ai jamais perçu de haine de leur part, plutôt un désir de paix.
L'Éclaireur - Quelles exactions avez-vous observées dans le Donbass ? Étaient-elles planifiées ou le fait de bataillons de volontaires livrés à eux-mêmes, comme des mercenaires après la guerre de Trente ans ? Y avait-il une volonté politique d’écraser toute contestation ?
Benoît Paré - On peut distinguer deux phases. Avant Minsk 2, c’était une guerre de mouvement où les bataillons de volontaires, comme Azov, ont commis les pires exactions, surtout jusqu’à Minsk 1. Les combats étaient violents. Mais après Minsk 2 en 2015, la ligne de front s’est stabilisée, et la violence a globalement diminué. Cependant, des bombardements sporadiques persistaient, notamment au sud de Mariupol, où les violations du cessez-le-feu étaient quotidiennes jusqu’en 2022.
D’autres zones, comme Avdiivka, connaissaient des flambées de violence, par exemple en juillet 2017, en raison d’enjeux stratégiques comme le contrôle des routes. À Donetsk, une station d’épuration d’eau dans la zone grise était régulièrement ciblée par les forces ukrainiennes. Des zones comme Louhansk ou Zolote étaient aussi très tendues. Les Ukrainiens utilisaient une tactique de « petits pas », grignotant du terrain dans la zone grise sans lancer de grandes offensives, pour respecter les accords de Minsk tout en maintenant la pression. Arsen Avakov, dans une interview, assumait cette stratégie de progression lente pour éviter une attention internationale. Les Ukrainiens rêvaient d’une offensive décisive, inspirée de l’opération Tempête croate de 1995, qui avait chassé les Serbes des Krajinas. Ce modèle était évoqué par des figures comme Andreï Biletsky, ex-chef d’Azov. Beaucoup en Occident croyaient que les sanctions de 2014 feraient s’effondrer la Russie économiquement et politiquement, une illusion qui prenait leurs désirs pour la réalité.
L'Éclaireur - La Russie dispose des plus grandes ressources naturelles au monde, d’une population bien éduquée et d’une autonomie agricole, énergétique et industrielle. Comment croire que son économie s’effondrerait?
Benoît Paré - C’est ce qu’on appelle en français “prendre ses désirs pour la réalité”, ou en anglais, le wishful thinking. Comme des enfants qui veulent quelque chose si fort qu’ils croient que cela arrivera. Cette vision reposait sur une caricature de la Russie, déconnectée de sa résilience.
L'Éclaireur - Dès le début de l’opération spéciale russe, la Russie a pris le contrôle de Tchernobyl pour sécuriser les déchets et combustibles nucléaires. À Zaporijjia, Trump a même déclaré que les États-Unis pourraient gérer la centrale. Compte tenu du passé de l’Ukraine dans le trafic d’armes et la prolifération nucléaire dans les années 90, pensez-vous que la question nucléaire est centrale dans ce conflit ?
Benoît Paré - Certains ont affirmé que Zelensky, dans son discours de Munich en février 2022, avait exprimé le souhait de réacquérir des armes nucléaires. J’ai relu ce discours et n’y ai pas trouvé de référence explicite, mais des commentaires suggèrent qu’il a été édulcoré. Je ne peux donc pas confirmer.
Concernant Zaporijjia, l’Ukraine contrôle encore deux autres centrales nucléaires, ce qui leur fournirait des matériaux pour une éventuelle « bombe sale » si c’était leur intention. Je pense que reprendre Zaporijjia est plutôt un enjeu énergétique, car c’est la plus grande centrale d’Europe, essentielle pour l’Ukraine.
En 2014, la question nucléaire ne semblait pas prioritaire. Le mémorandum de Bucarest de 1994, qui a acté le transfert des armes nucléaires ukrainiennes à la Russie en échange de garanties sur son intégrité territoriale, est souvent invoqué par les pro-Ukrainiens pour accuser la Russie de violation. Mais ce mémorandum était aussi un moyen pour Kiev de contrer les velléités d’indépendance de la Crimée, en conditionnant le retour des armes à la reconnaissance de son contrôle sur la péninsule.
L'Éclaireur - Le mémorandum de Bucarest n’est pas le plus important. C’est le protocole de Lisbonne, signé dans le cadre du traité START et validé par l’ONU, qui obligeait la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ukraine à transférer leurs armes nucléaires à la Russie, successeur de l’URSS. Si les deux premiers l’ont fait sans problème, l’Ukraine a exigé des compensations financières pour des matériaux qu’elle ne possédait pas. N’était-ce pas avant tout un chantage financier, même si la Crimée jouait un rôle ?
Benoît Paré - Les deux aspects se mêlent probablement. Les Ukrainiens saisissent toute opportunité de profit, comme l’a dit Oleksiy Arestovytch, cité dans mon livre, soulignant leur propension à la corruption. Mais conserver la Crimée était crucial pour la viabilité de l’État ukrainien. Le protocole de Lisbonne a été complété par le mémorandum de Bucarest pour garantir l’intégrité territoriale, en réponse aux réticences ukrainiennes.
L'Éclaireur - Un mémorandum n’a pas de force juridique, contrairement au protocole de Lisbonne, que l’Ukraine n’a jamais pleinement respecté…
Benoît Paré - Exactement, un mémorandum n’est pas un traité. Les Russes, de leur côté, estiment que l’Ukraine a violé elle-même son intégrité territoriale par le coup d’État de Maïdan, qu’ils jugent illégitime et contraire aux droits de la population.
L'Éclaireur - Comment envisagez-vous une résolution de ce conflit, vus les obstacles ?
Benoît Paré - Je ne suis pas optimiste. Les nationalistes ukrainiens, très jusqu’au-boutistes, interdisent toute concession à Zelensky, comme en témoignent leurs récentes déclarations. Déjà à l’époque des accords de Minsk, un diplomate français m’avait confié que si Zelensky les appliquait, il risquait d’être assassiné, comme Yitzhak Rabin après les accords d’Oslo en 1995. Dès son arrivée au pouvoir, Zelensky a reçu des menaces explicites, notamment de l’ex-chef de Secteur droit, cité dans mon livre.
L'Éclaireur - Zelensky a été élu avec le soutien des Américains et d’Ihor Kolomoïsky, un oligarque ukrainien finançant des bataillons néo-nazis. C’est assez paradoxal, non ?
Benoît Paré - Oui, mais il a été élu en 2019 avec 73 % des voix grâce à son discours promettant de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Pourtant, il l’a au contraire intensifiée. Je pense qu’il était peut-être sincère au départ, mais il a vite été contraint par les nationalistes et l’État profond américain.
Quelques jours après son élection, 70 ONG ukrainiennes, financées par des agences américaines comme l’USAID, le Département d’État, l’OTAN et Soros, ont publié un mémorandum menaçant de troubles s’il faisait des concessions, comme assouplir les lois anti-russes ou négocier avec les séparatistes sans l’aval occidental. Ce texte semblait dicté par le Département d’État, même sous Trump, qui ne maîtrisait pas grand-chose face à des figures comme Mike Pompeo, un représentant de l’État profond.
L'Éclaireur - Un avocat américain a explicitement qualifié Pompeo de néoconservateur, dans la lignée de Victoria Nuland. Trump était dépassé, mal entouré, et le Russia Gate pesait sur lui…
Benoît Paré - Oui, Trump manquait d’expertise et d’alliés fiables. L’État profond a continué son agenda. Un avocat, Bob Amsterdam, qui défend l’Église orthodoxe ukrainienne rattachée à Moscou, a expliqué dans une interview avec Tucker Carlson que le schisme religieux en Ukraine, séparant l’Église de l’État de celle de Moscou, était un plan conçu par Nuland et exécuté par Pompeo.
L'Éclaireur - On a vu un schéma similaire en ex-Yougoslavie avec l’Église macédonienne…
Benoît Paré - Je n’ai pas étudié ce cas, mais pour l’Ukraine, l’implication américaine dans ce schisme est crédible.
L'Éclaireur - Les Russes ont-ils raison de vouloir « résoudre le problème ukrainien » en parlant de dénazification ? Les bandéristes, soutenus dès les années 1940 par les Anglo-Saxons, la CIA, et les Allemands via Reinhard Gehlen, un criminel de guerre, ne sont pas un phénomène récent. N’est-ce pas une question de dénazification face à une guerre d’extermination ?
Benoît Paré - Le terme « dénazification » a choqué beaucoup, surtout avec Zelensky, qui est juif. Certains y voyaient un prétexte absurde. Mais ceux qui connaissent l’Ukraine savent que c’est plus complexe. Un militant d’extrême droite ukrainien, dans une interview, disait être contre un président juif mais que cela servait leur cause, car cela masquait leur agenda nationaliste.
Zelensky leur offrait un alibi. Il s’est vite retrouvé sous la coupe des nationalistes, soutenus par l’État profond américain, qui les utilisaient comme relais. L’Occident n’a jamais sanctionné ces groupes. Svoboda, à l’origine néo-nazi, et le parti de Biletsky, proche du national-socialisme, affichaient ouvertement des symboles extrémistes. Le Sénat américain a brièvement interdit de financer Azov, mais cette restriction a été levée.
L'Éclaireur - Les Américains ont infiltré les postes clés de l’appareil ukrainien avec leurs conseillers et ces ultranationalistes, que j’appelle néo-nazis. L’OTAN, les Allemands, les Britanniques, et peut-être les Français ont financé et formé Azov, avec des preuves visuelles dès avant 2022…
Benoît Paré - Oui, la base de Yaroviv, près de Lviv, servait à l’entraînement des forces ukrainiennes par l’OTAN, bombardée par la Russie en mars 2022. Je ne sais pas si Azov y était spécifiquement formé, mais de nombreuses unités l’étaient.
Concernant l’avenir, des extrémistes ukrainiens, bien armés et potentiellement soutenus par des acteurs extérieurs, pourraient mener une guérilla terroriste, même en cas d’accord de paix. Le site Myrotvorets, qui liste les « ennemis » de l’Ukraine depuis 2014, inclut des politiciens et journalistes occidentaux, certains assassinés. Ce fanatisme nationaliste risque de perdurer, comme la guérilla bandériste des années 1940-50, soutenue par la CIA et les Britanniques.
L'Éclaireur - Ce terrorisme pourrait frapper l’Europe, visant ceux perçus comme traîtres à la cause ukrainienne. Cette guérilla ne s’est arrêtée qu’après l’exécution de Bandera par le KGB. Faudra-t-il en arriver là ?
Benoît Paré - C’est triste à dire, mais nous n’en sommes pas là. Le conflit reste dans une logique de confrontation sans accord. Vu le jusqu’au-boutisme des nationalistes, je suis pessimiste.